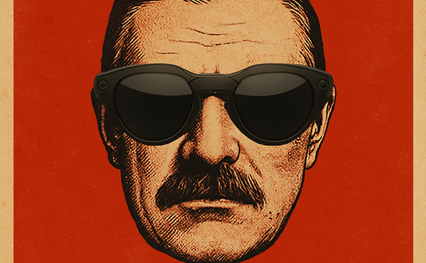- Accueil
- Transformation numérique
- Compétition numérique et sécurité nationale : Washington et Pékin sur une ligne de fracture
Compétition numérique et sécurité nationale : Washington et Pékin sur une ligne de fracture


L’instauration de tarifs douaniers punitifs sur des centaines de milliards de dollars de produits chinois, sous l’impulsion de l’administration Trump, a constitué le point de départ d’un découplage économique entre les deux puissances. Mais au-delà des échanges commerciaux, c’est la course à la suprématie numérique qui cristallise une part importante des tensions. En 2019, les États-Unis ont placé le géant Huawei sur une liste noire, l’accusant de menacer la sécurité nationale en facilitant un potentiel espionnage au profit de Pékin via ses infrastructures 5G. Cette décision a marqué un tournant stratégique : pour Washington et Pékin, le cyberespace n’est plus seulement un espace économique ou informationnel, mais un domaine à sécuriser militairement.
Des politiques de souveraineté numérique
Les autorités chinoises ont accéléré leurs efforts de souveraineté numérique, à travers des programmes comme « Made in China 2025 » et surtout « China Standards 2035 », qui vise à imposer les normes techniques chinoises dans les technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, l’IoT, la 5G et plus généralement dans la cybersécurité. Pékin perçoit les restrictions imposées par les États-Unis sur les semi-conducteurs et les logiciels stratégiques (comme ceux de Nvidia ou AMD) comme une tentative d’endiguement numérique. En réponse, les investissements chinois dans les technologies critiques explosent, soutenus par des partenariats publics-privés et des subventions massives. Ces initiatives visent à réduire la dépendance chinoise vis-à-vis des importations et ainsi à renforcer son autonomie (et par extension sa souveraineté) dans le numérique et la production de semi-conducteurs.
En réponse, les États-Unis ont formalisé leur propre stratégie de sécurisation numérique avec le CHIPS and Science Act, promulgué en 2022, qui alloue 52 milliards de dollars à la relocalisation de la production de puces électroniques et à la recherche technologique, avec pour objectif explicite de « contrer la Chine ». L’ensemble de ces politiques, des deux côtés, s’inscrit dans une logique de sécurité nationale, où les infrastructures numériques, les données et les systèmes critiques sont perçus comme des leviers de puissance et des cibles potentielles. Des cibles qui subissent de plus en plus de cyberattaques.
« Défense vers l’avant et d’engagement persistant »
Depuis 2021, les affrontements cyber entre les États-Unis et la Chine se sont intensifiés, marqués par une série d’opérations offensives et de contre-accusations. L’attaque massive contre Microsoft Exchange, attribuée au groupe chinois Hafnium, a compromis des dizaines de milliers de serveurs dans le monde, amorçant une escalade majeure. En mai 2023, la NSA et Microsoft révèlent l’existence de Volt Typhoon, un groupe de cyber espionnage chinois ciblant les infrastructures critiques américaines comme les communications, l’énergie ou les transports. Par la suite, le FBI et la CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) publient une alerte indiquant que ce groupe pourrait préparer des sabotages en cas de conflit autour de Taïwan. De son côté, la Chine accuse Washington d’avoir mené des cyberattaques contre les Jeux asiatiques d’hiver à Harbin, visant les systèmes de sécurité et de coordination. Fin 2023, des analystes américains détectent des présences persistantes de Volt Typhoon dans plusieurs systèmes critiques, via des webshells furtifs. Les Webshells sont des cyberattaques par lesquelles un pirate exploite les vulnérabilités d’un site web ou d’une application web pour télécharger un script malveillant sur le serveur. Les États-Unis ont réagi en multipliant les mesures de cyberdéfense : durcissement des protocoles de sécurité au sein des agences fédérales, campagnes d’attribution publique visant à isoler diplomatiquement les groupes hostiles, et renforcement de la coopération avec les alliés du Pacifique à travers des partenariats comme les Five Eyes. Le Commandement Cyber américain a également adopté une posture dite de “Défense vers l’avant et d’engagement persistant ”, qui consiste à neutraliser les menaces dès leur apparition, y compris hors du territoire national. Sans compter la prise en compte de l’IA, qui est actuellement l’un des points chauds des tensions sino-américaines.
La guerre de l’IA
Dans son article « IA : La guerre entre les États-Unis et la Chine fait rage », Ghislain de Lammerville explique que la compétition technologique entre Washington et Pékin s’est transformée en une véritable course à la domination dans le domaine de l’intelligence artificielle, reflet d’une lutte plus large pour la suprématie stratégique mondiale. Du côté américain, les grandes entreprises de la tech comme Google, Microsoft, Meta ou OpenAI occupent une position dominante, concentrant à elles seules la majorité des investissements mondiaux en IA, estimés à plus de 60 milliards de dollars en 2023. Cette dynamique est soutenue par une stratégie fédérale cohérente, mêlant incitations financières, cadre législatif et coordination avec le secteur privé. Le gouvernement américain a ainsi mis en place plusieurs dispositifs, parmi lesquels l’American AI Act de 2019, un décret présidentiel encadrant les usages publics de l’IA en 2023, et un mémorandum renforçant l’intégration de l’intelligence artificielle dans les agences de renseignement en 2024. En 2025, l’administration Trump lance le projet Stargate, doté de 500 milliards de dollars, destiné à développer l’infrastructure d’une intelligence artificielle générale, considérée comme un pilier de la puissance nationale future.
Face à cette mobilisation, la Chine n’est pas en reste. Depuis 2017, sous l’impulsion directe de Xi Jinping, elle a engagé une stratégie industrielle et étatique massive pour devenir leader mondial dans le domaine. Les géants technologiques chinois, souvent appelés les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi), ont investi près de 6 milliards de dollars dans l’IA, tandis que les subventions publiques ont dépassé les 70 milliards d’euros sur la période 2019-2020. Pékin entend ainsi réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies occidentales et imposer ses propres standards en matière d’intelligence artificielle. La Chine domine désormais en nombre de publications scientifiques et de dépôts de brevets liés à l’IA. Elle a récemment dévoilé DeepSeek, un modèle de grande ampleur visant à concurrencer les modèles d’OpenAI. Cependant, le modèle chinoise accuse des critiques récurrentes sur l’encadrement étatique, le manque de transparence et les usages potentiels à des fins de surveillance. Ghislain de Lammerville montre que cette confrontation dépasse largement le champ de l’innovation technologique pour s’inscrire dans une logique de rivalité systémique. L’IA devient à la fois un outil de contrôle, un vecteur de puissance économique, un multiplicateur de capacités militaires et un instrument d’influence normative sur la scène internationale.
la newsletter
la newsletter