![Les sept familles de la [souveraineté numérique] à la française (1/2)](https://incyber.org//wp-content/uploads/2024/03/adobestock-749446930-1920x735.jpeg)
- Accueil
- Souveraineté numérique
- Les sept familles de la souveraineté numérique à la française (1/2)
Les sept familles de la souveraineté numérique à la française (1/2)
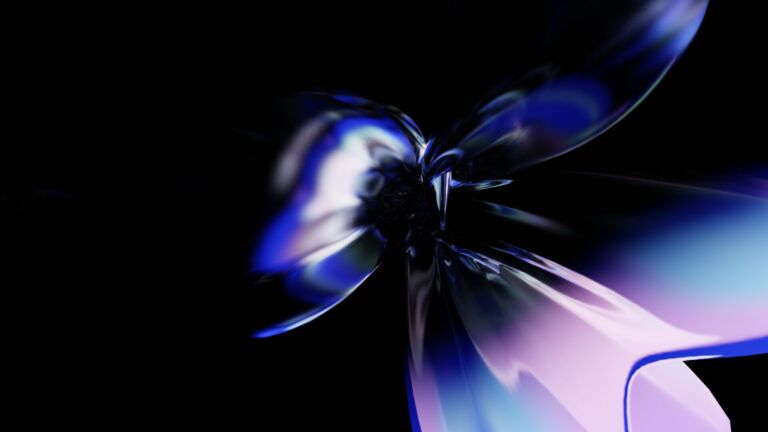
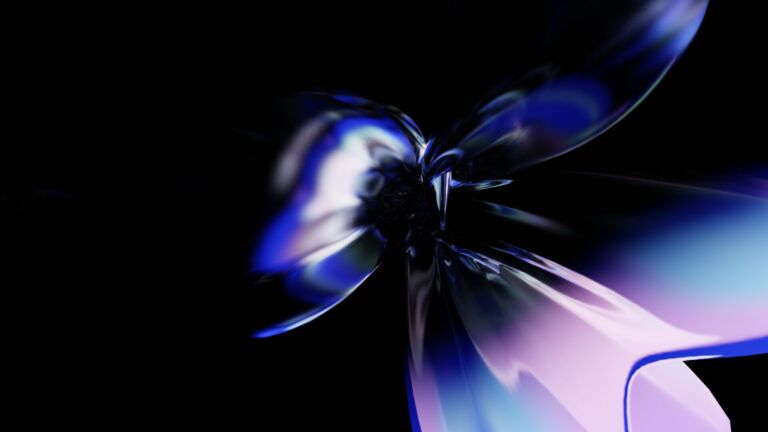
C’est à Bernard Benhamou et Laurent Sorbier que nous devons l’expression de « souveraineté numérique ». En 2006, les deux experts mettaient en garde les décideurs politiques contre l’hégémonie américaine dans la gouvernance d’Internet, « nouveau terrain où se joue désormais la puissance économique, militaire et politique ». Le concept sera repris avec succès par Pierre Bellanger, dans un ouvrage grand public.
Vingt ans plus tard, le numérique est un des leviers majeurs de la souveraineté des États, acquérant au moins autant d’importance « qu’en ont eu le charbon et l’acier en leur temps », comme le rappelait Philippe Dewost dans un essai historique marquant. Mieux, le numérique deviendrait lui-même « souverain », en « gouvernant silencieusement toutes les autres formes de pouvoir », observe Bertrand Leblanc-Barbedienne, fondateur du média Souveraine Tech.
Les autonomistes, garants du régalien (1)
La « famille » autonomiste recherche autant l’autonomie stratégique que la performance, spécialement dans les domaines régaliens du renseignement et du secret – à l’image du réseau classifié ISIS développé par l’OSIIC, ou bien de la messagerie sécurisée Tchap, développée par la DINUM. Pour autant, cette doctrine ne repose pas sur une logique absolutiste de « repli sur soi ». Elle privilégie plutôt une approche par degré, en fonction de la criticité des besoins.
Le ministère des Armées a ainsi créé un réseau de fournisseurs de confiance (qualifiés LPM, NIS1, Otan…), ultraspécialisés. C’est le cas d’ERCOM (Thalès) en cryptographie, Airbus Defense & Space ou encore de Preligens pour les satellites de renseignement. L’État s’assure une place prépondérante dans cet écosystème, par le biais de participations, de qualifications et de certifications, n’hésitant pas à marquer publiquement son soutien à certains acteurs (comme pour la messagerie sécurisée Olvid par exemple). Autant d’éléments qui lui garantissent une liberté d’action numérique sans entraves.
Deux enjeux conditionnent cependant cette autonomie. D’un côté, le recrutement et la rétention d’experts de haut niveau pour la conception des produits « faits maison ». De l’autre, l’entretien d’un réseau de fournisseurs ayant assez d’envergure pour supporter l’incertitude des marchés publics et l’agilité nécessaire pour rester compétitif dans un secteur en mouvement perpétuel.
Les colbertistes centralisateurs (2)
S’inspirant de l’autonomisme régalien, les colbertistes souhaitent élargir le made in France à tous les pans du numérique par un soutien actif des pouvoirs publics. La tâche n’est pas aisée après une série d’échecs plus ou moins retentissants. Parfois lancées comme des projets européens, les initiatives colbertistes ont finalement achoppé sur une impossible coopération franco-allemande et sont devenues des échecs franco-français, comme pour les moteurs de recherche Quaero (pourtant présenté comme un futur « Airbus européen » par Jacques Chirac), et Qwant, qui n’ont, en tout état de cause, pas égalé Google.
Avant eux, le Plan Calcul, la nationalisation de Bull ou le « nanoréseau » du « Plan informatique Pour Tous » n’ont pas suffi à soutenir la filière du micro-ordinateur français. Jean-Pierre Brulé résumera l’échec de ces politiques publiques en évoquant un secteur informatique « malade de l’État », prisonnier d’un capitalisme de connivence et d’une prime aux grands acteurs.
Bernard Benhamou, fondateur en 2017 de l’Institut de la souveraineté, regrette de son côté qu’une partie des haut-fonctionnaires français, farouches partisans d’un réseau centralisé, « ne se sont jamais remis de la fin du Minitel dans les années 2000 ». Constat d’échec que partage en partie Pierre-Alexis de Vauplane, partner chez Ring Capital, qui retient en revanche la réussite indéniable de la Banque Publique d’Investissements (BPI) dans le soutien de la French Tech.
En 2012, ce sont les projets de Cloud Computing portés par deux coopérations, entre Orange et Thalès d’une part (Andromède) et entre SFR et Bull d’autre part (Numergy), qui ont été financés par un État désireux de « restaurer la souveraineté numérique de la France ». « Plus de deux ans après la naissance de ces futures locomotives, le bilan n’est pas très glorieux », jugera Delphine Cuny dans La Tribune. Heureusement, les colbertistes centralisateurs ne sont pas les seuls défenseurs du Made in France.
Les corsaires, ou le Made in France offensif (3)
La famille des « corsaires » regroupe tous ceux qui comptent moins sur la commande publique que sur leur génie propre pour conquérir des marchés à l’international et faire émerger une French Tech pérenne. Ils souffrent cependant d’une pénurie de capitaux au sein du marché européen : « L’Europe investit six fois moins que les États-Unis dans le Venture Capital », déplore Pierre-Alexis de Vauplane, dans son essai sur le numérique.
Pour autant, la France, avec vingt « licornes » dans le numérique, peut s’enorgueillir de compter de très grandes réussites, à l’image de BlaBlaCar, Doctolib, ou Voodoo. Une liste qui devrait s’élargir avec les nombreuses « pépites » françaises ayant émergé dans les secteurs de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle ou du quantique. Les « corsaires » se réjouissent que « l’État stratège », ayant tiré leçon de ses échecs, se soit recentré sur un accompagnement de l’entrepreneuriat qui porte aujourd’hui ses fruits.
Pour autant, les corsaires ne veulent pas seulement voir émerger des licornes, par définition exceptionnelles, mais aussi ce que l’entrepreneur Romain de Lacoste, co-fondateur de la startup Commines, qualifie de « bicornes » : des PME de taille humaine et à haute-valeur ajoutée, dont le tissu économique français est constitué en majorité.
la newsletter
la newsletter
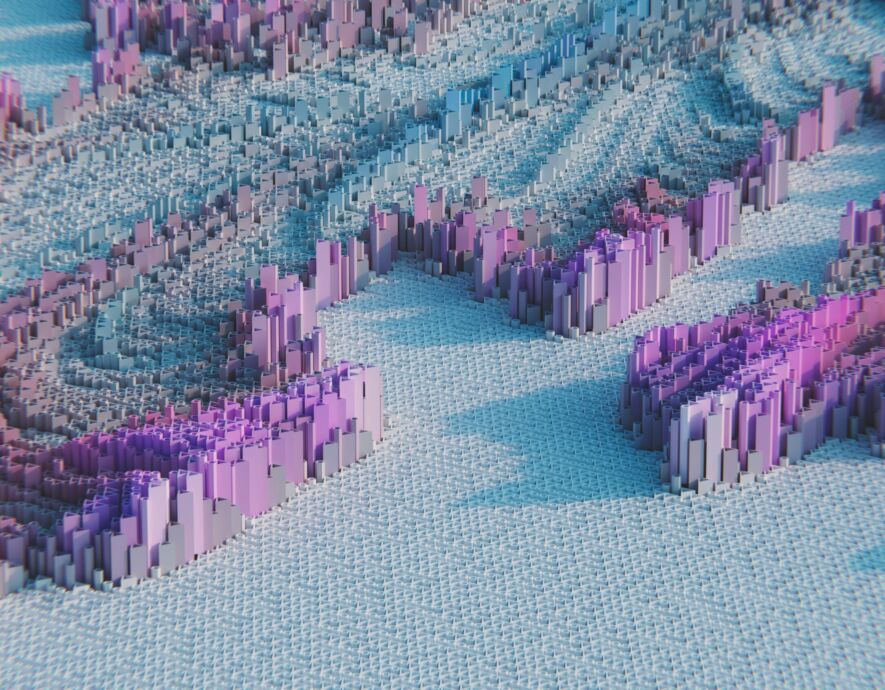


![Image [Commission d’enquête sur la commande publique] La souveraineté numérique en France, un "avion sans pilote"](https://incyber.org//wp-content/uploads/2025/06/incyber-news-computers-cybersecurite-cybersecurity-885x690.jpg)