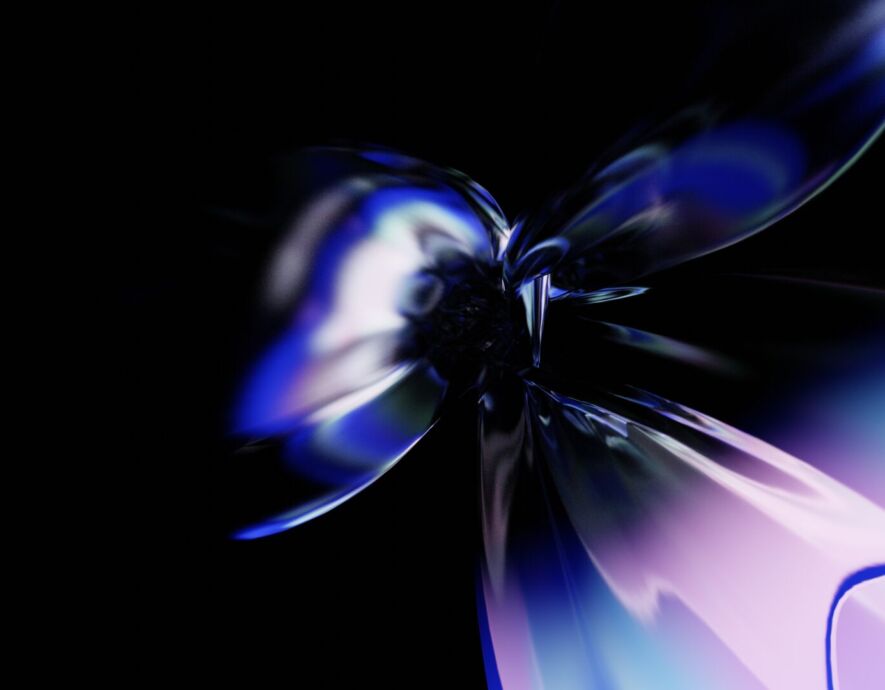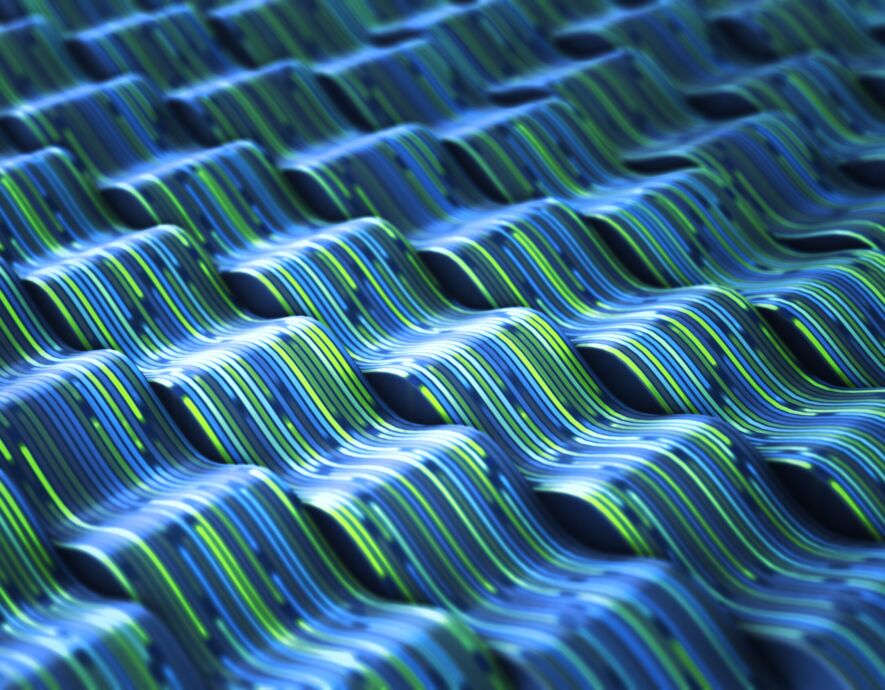![Les technologies de l’information au cœur des [tensions géopolitiques]](https://incyber.org//wp-content/uploads/import/post/2014/08/itp-la-geopolitique-faconne-le-cyberespace-selon-le-dernier-rapport-cisco-1280x735.jpg)
- Accueil
- Transformation numérique
- Les technologies de l’information au cœur des tensions géopolitiques
Les technologies de l’information au cœur des tensions géopolitiques


Charleyne Biondi : « Sans coopération autour d’un certain nombre de standards, l’efficacité des réglementations reste inévitablement limitée »
Le règlement européen sur les services numériques (DSA) prévoit que la Commission européenne inflige aux plateformes des amendes pouvant aller jusqu’à 6 % de leur chiffre d’affaires mondial en cas de diffusion de contenus illicites ou préjudiciables, dont la désinformation. Si, au regard du droit européen, cette sanction est importante, n’est-elle pas minime du fait du modèle économique de ces plateformes ? Existerait-il d’autres moyens de lutter contre la manipulation de l’information et des ingérences étrangères, comme, par exemple, renforcer le régime de responsabilité de ces entreprises ?
Le DSA représente une avancée significative dans la régulation des contenus illicites et la désinformation en ligne. 6 % du chiffre d’affaires mondial d’une entreprise du numérique constitue un montant assez important pour pouvoir dissuader les violations, mais cela n’adresse effectivement pas la racine du problème : le modèle économique de ces plateformes qui favorise l’engagement, la viralité, au détriment de la qualité de l’information. Par ailleurs, la mise en œuvre du DSA pose un certain nombre de défis juridiques, particulièrement quand les plateformes ciblées ont leur siège et leurs principales opérations en dehors de l’Union européenne. On a bien vu, avec le GDPR, comment certains géants du numérique avaient plus ou moins mis en échec la norme européenne en adoptant des mesures minimales pour apparaître en conformité. Sans alignement international, sans coopération autour d’un certain nombre de standards, l’efficacité de ces réglementations reste inévitablement limitée.
La part de l’Union européenne dans le PIB mondial est passée d’environ 25 % en 2000 à moins de 15 % actuellement (notamment suite au Brexit). Pourrait-elle se retrouver colonisée en matière numérique ?
Ce recul peut déjà être imputé, en partie, au « retard » technologique européen, qui crée depuis 20 ans les conditions d’une forme de colonisation numérique : en d’autres termes, le manque d’innovation en Europe nous a contraints à adopter de plus en plus de technologies étrangères. Si l’Europe a bien développé des services numériques, ceux-ci sont tous dépendants d’infrastructures fournies par des entreprises étrangères, de la 5G aux puces en passant par le cloud. Ces dépendances créent, bien sûr, une asymétrie économique – les infrastructures représentant une part considérable de la chaîne de valeur technologique, mais pose aussi un nombre croissant de défis pour la souveraineté des États européens, dont un nombre croissant de fonctions critiques sont désormais alimentées par des entreprises étrangères.
Mark Zuckerberg a annoncé, mardi 7 janvier, des changements dans la politique de modération des contenus sur Facebook et Instagram, dont la suppression des partenariats de fact-checking avec des médias et la diminution de la modération automatique. La décision de Zuckerberg pourrait-elle être suivie par d’autres plateformes ? Quelles seraient les conséquences ?
L’annonce de Mark Zuckerberg sur la fin de la modération des contenus, si elle est appliquée à la lettre, mettrait Meta en porte-à-faux avec les exigences du DSA dans l’Union européenne. Le DSA impose en effet aux plateformes des mesures de modération proactive pour la détection et la suppression de contenus haineux, nuisibles ou illégaux, et des exigences de transparence sur les méthodes de modération employées. En dépit du risque de sanction important, cela n’a pourtant pas l’air d’inquiéter les géants de tech américains, qui se sentent sans doute encouragés dans cette posture de défiance par l’arrivée de la nouvelle administration Trump. La domination américaine sur le secteur des technologies (et nos dépendances qui en découlent) confère en effet aux États-Unis un levier de négociation important qui pourrait bien affaiblir, voire acculer, les velléités réglementaires européennes.
Aujourd’hui, les plateformes numériques sont également chinoises, comme TikTok. Cette dernière a été étiquetée par le Congrès américain et la Cour suprême comme menace à la sécurité nationale et pourrait être bannie du territoire étatsunien. En avril 2024, le Parlement européen réclamait des explications au réseau social sur les risques d’addiction liés au déploiement en France et en Espagne d’un service rémunérant les utilisateurs qui regardent des vidéos. Une interdiction de TikTok dans l’Union européenne est-elle envisageable ?
Aux États-Unis, le cas TikTok doit être remis dans le cadre de tensions géopolitiques avec la Chine, qui se cristallisent depuis plusieurs années autour des questions technologiques. TikTok est une « menace » frontale et immédiate à la domination des réseaux sociaux de Mark Zuckerberg – Meta et Instagram. Dans les États où TikTok a été banni, comme en Inde, c’est le géant américain qui a remporté l’essentiel des parts de marché. Il y a donc un fort enjeu économique – au-delà des considérations éthiques, difficilement démontrables par ailleurs, sur la dangerosité supposée de l’algorithme de TikTok. La situation est bien différente pour l’Union européenne, dont la population est de toutes façons l’otage volontaire de réseaux sociaux étrangers. Pour interdire TikTok, il faudrait réussir à précisément démontrer à quel point et en quels points TikTok serait significativement plus dommageable au consommateur que les réseaux sociaux concurrents (et américains). Ou alors, décider pour des raisons politiques de renoncer à la technologie chinoise – mais là encore, l’Union européenne n’a pas les moyens de ce genre d’indépendance aujourd’hui. Et nos panneaux solaires ? Et la 5G ?
En réaction à l’attaque de TikTok auxÉtats-Unis, l’Assemblée nationale populaire de Chine a annoncé que d’ici trois ans, les grandes entreprises chinoises devront remplacer tous leurs logiciels étrangers par des logiciels chinois. La Chine se dirige-t-elle, à l’instar de la Russie, vers un « Runet souverain » ?
Le Runet avait relancé le mouvement d’une fragmentation de l’internet global, et la Chine l’accélère. Ce n’est pas une annonce étonnante, aux vues de la stratégie numérique chinoise, construite depuis toujours autour de deux axes forts : la sécurité nationale et le leadership mondial. La Chine a d’ailleurs déjà sécurisé son indépendance à plusieurs niveaux stratégiques – sur l’extraction des terres rares et leur transformationet désormais, sur les modèles de fondation en IA, en démontrant d’ailleurs une très grande capacité d’innovation en software.
Julien Nocetti : « Nous avons aujourd’hui affaire à des États qui ont fait de l’instrumentalisation de l’information un levier majeur de leur politique étrangère »
Les attaques informationnelles sont de plus en plus souvent orchestrées dans le cadre d’opérations organisées et aujourd’hui, plus de la moitié des Français sont confrontés plusieurs fois par semaine à des fake news sur les réseaux sociaux. Quels sont les enjeux de cette guerre informationnelle ?
Ces enjeux ont lieu à plusieurs niveaux : c’est un enjeu pour les États, confrontés à des campagnes de manipulation de l’information qui se montrent de plus en plus décomplexées dans leur visée et sophistiquées dans leur « chaîne d’approvisionnement », comme on l’a vu dans l’affaire du premier tour de l’élection présidentielle roumaine à l’automne dernier.
Nous avons aujourd’hui affaire à des États, des compétiteurs stratégiques – comme la Russie, la Chine, l’Azerbaïdjan, l’Iran ou encore la Turquie – qui ont fait de l’instrumentalisation de l’information un levier majeur de leur politique étrangère. Cette politique touche en premier lieu les États, et par répercussion les populations, comme celle de la France ; cette instrumentalisation de l’information consiste à aller « labourer » la réception de l’information par les populations sur des thématiques clivantes, comme la situation socioéconomique, l’immigration, les élections qui sont par nature des périodes d’incertitude, etc.
Malheureusement, la plupart des personnes ne sont pas immunisées contre de tels risques informationnels ; la résilience est longue et difficile à bâtir et implique des efforts venant du haut, de nos dirigeants, et également venant du bas, c’est-à-dire une éducation au long court des citoyens sur les risques liés aux usages des réseaux sociaux, sur l’importance de hiérarchiser l’information, etc.
Les réseaux sociaux sont devenus un terrain de jeu pour les services russes, qui s’en servent notamment pour diffuser des fausses informations. Comment s’organise cette stratégie cyber ?
Cette stratégie est éprouvée : elle n’est pas née avec l’invasion de l’Ukraine en 2022, ni avec celle de la Crimée en 2014. Mais la période 2012-2014 marque quand même une évolution dans la politique russe : Vladimir Poutine revient au pouvoir en 2012 après un cycle de manifestations dans les grandes villes russes, organisées en grande partie grâce aux réseaux sociaux. Ces événements ont donné aux dirigeants russes une perception bien plus vive du potentiel du numérique à des fins de mobilisation politique. Les années suivantes, l’appareil de lutte informationnelle et de cyberdéfense russe entame une réelle remontée en puissance pour prendre en compte ces facteurs dans l’évolution de l’engagement russe sur ce front-là, en particulier car le gouvernement a pris conscience que les forces de l’OTAN mobilisent des moyens conventionnels supérieurs. La Russie reprend l’idée assez ancienne, mais réactualisée avec le numérique, qu’elle peut profiter de son infériorité sur le terrain conventionnel pour aller déstabiliser en profondeur les sociétés occidentales adverses.
Cette antériorité des modes de pensée stratégique russe est héritée des réflexions conduites à l’époque soviétique – mais aussi de l’époque tsariste, où les services du Tsar avaient conscience que la désinformation pouvait être utilement mobilisée. Ces stratégies ont été intégrées au sein du régime bolchevique et mobilisées au profit de l’appareil du Parti et de l’Armée rouge : les services de renseignement étaient des acteurs majeurs de cette lutte informationnelle et cette politique a été reprise par la Russie post-soviétique, notamment par les trois principaux services que sont le FSB (contre-espionnage), le SVR (renseignement extérieur) et le GRU (renseignement militaire) – et la myriade de groupes, pérennes ou ad hoc, affiliés à ces institutions.
Le 24 août 2024, Pavel Dourov, cofondateur de la messagerie Telegram, était arrêté à l’aéroport du Bourget, dans le cadre d’un mandat de recherche. Accusé de complicité concernant Telegram, où des crimes graves ont lieu, il est actuellement sous contrôle judiciaire. Il a annoncé fin septembre que sa plateforme transmettra les adresses IP et les numéros de téléphone à la demande des autorités. Que faut-il comprendre de cette promesse ? Cette décision peut-elle réellement changer les règles de modération de Telegram ?
Ce sujet est délicat, déjà car cette arrestation a eu lieu en plein Jeux olympiques ; d’autre part, il est rarissime d’appréhender un grand patron de la tech ; le fait que cet événement se produise en France est un événement assez significatif en soi. Quant à savoir si cette arrestation et les enquêtes qui ont eu lieu vont permettre de changer les règles de modération et les pratiques que l’on critique chez ces plateformes, et notamment les messageries chiffrées, vont évoluer, rien n’est sûr. Si ces messageries, dont Telegram, donnent parfois des gages de comportement vertueux, elles comptabilisent des centaines de millions d’utilisateurs, et les États ne sont qu’un de leurs interlocuteurs parmi d’autres. Ces plateformes savent bien s’affranchir des règles des États. Il ne faut donc peut-être pas surestimer l’arrestation de Pavel Dourov, même si un signal politique a été envoyé, qui montre que ces acteurs peuvent être rattrapés par la justice d’Etats démocratiques.
La 5G est actuellement déployée dans de nombreux pays. Mais cette technologie est aussi au cœur de la rivalité sino-américaine : alors que l’Europe se trouve être un point stratégique pour l’expansion de la 5G, la Chine voit en elle une occasion d’affaiblir le rival américain en Europe tandis que les Etats-Unis ne veulent pas perdre leurs liens privilégiés avec les pays européens. Récemment, l’Allemagne a interdit l’utilisation des chinois Huawei et ZTE sur les réseaux 5G pour des raisons de sécurité. D’autres pays pourraient-ils prendre la même décision ?
Cette décision allemande est intéressante, car les débats sur la 5G et ces acteurs chinois sont anciens : il en était énormément question de 2018 à 2020 – juste avant la pandémie de Covid – à un moment où l’administration américaine était très active sur ce front antichinois, afin d’essayer d’inciter les alliés partenaires des américains à ne pas inclure Huawei et ZTE dans les appels d’offres que ces États lançaient pour mettre en place leur réseau 5G. Jusqu’à récemment, les positions des principaux pays européens avaient été relativement souples : il y avait l’idée qu’il fallait rester méfiants vis-à-vis des acteurs chinois mais ne pas les exclure explicitement.
L ’Allemagne a maintenant pris les devants ; est-ce susceptible de changer la donne ? Je ne le sais pas, car il est bien moins question de la 5G qu’auparavant – aujourd’hui, la mise en avant économique et politique principale est l’intelligence artificielle. Je prendrais la question de manière plus large : les États européens vont-ils suivre ou non la nouvelle administration Trump dans un agenda antichinois qui sera considérablement renforcé par rapport à ce qu’il était sous Joe Biden, et même lors du premier mandat de Donald Trump ? Cette question concerne les réseaux 5G, mais aussi les réseaux sociaux de type TikTok. Nous verrons si le positionnement européen, parfois qualifié de troisième voie face à la rivalité sino-américaine, sera soutenable dans la durée, à un moment où les Etats-Unis ne cachent pas leur volonté d’offensive contre les régulations mises en place par l’Union européenne.
la newsletter
la newsletter