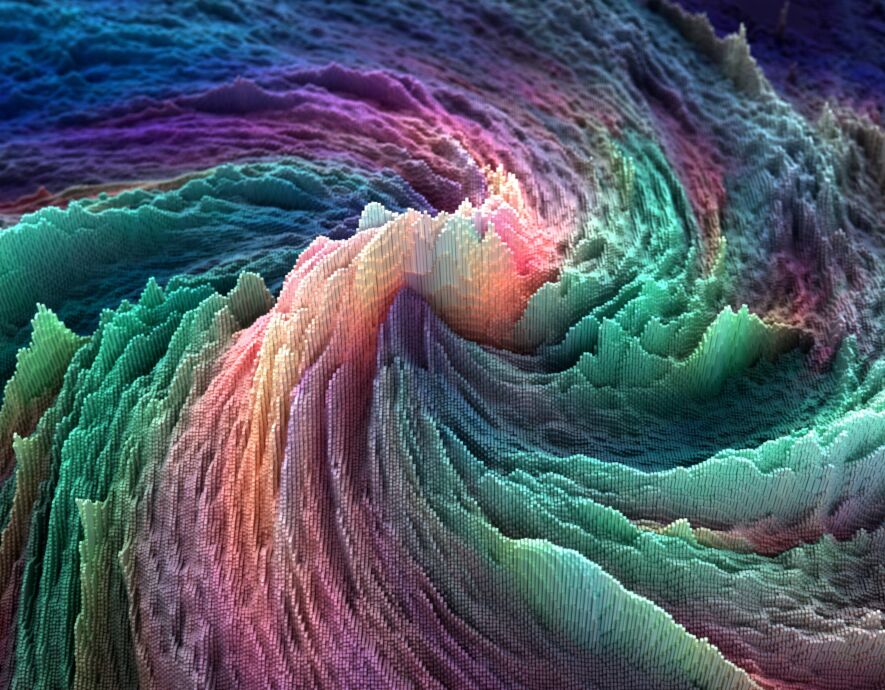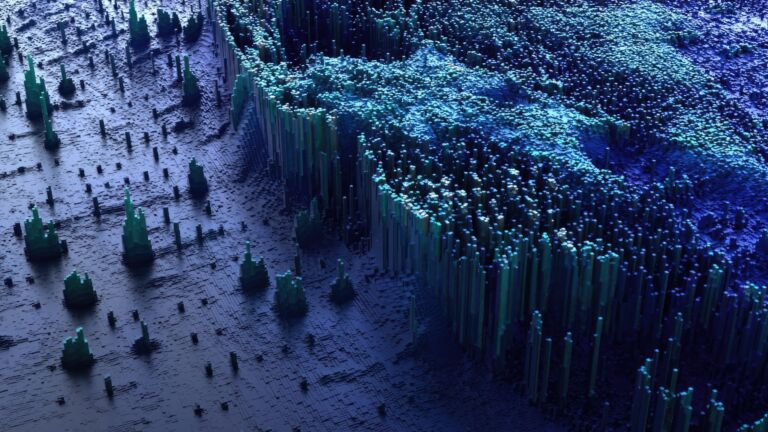
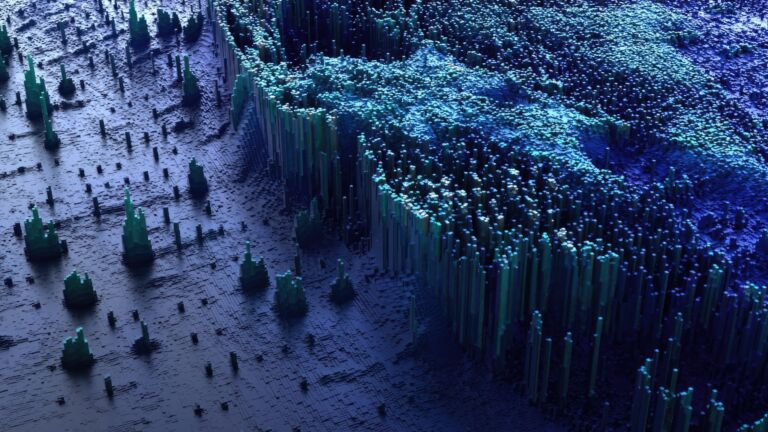
L’anticipation du monde de Time Out propose principalement deux postulats sociaux : la disparition de la monnaie fiduciaire (pièces et billets) et le cloisonnement de la ville. Le développement de l’intrigue, quant à lui, repose sur une licence créative, un unique élément de suspension consentie de l’incrédulité : dans cet avenir, les humains sont tous génétiquement modifiés pour ne plus vieillir à compter de 25 ans.
L’argent ayant été remplacé par du « temps à vivre », cette nouvelle monnaie s’échange, se troque, est volée, épargnée, thésaurisée… tant et si bien que pour éviter une inévitable surpopulation — potentiellement immortels, les humains ne sont pas pour autant stériles —, les humains meurent de « pauvreté temporelle » quand ils n’ont plus de « temps à vivre »… À l’inverse, la richesse est synonyme de décennies, même de siècles ! Ce temps qui vaut de l’or est affiché sur un compteur, un tatouage évolutif au gré des transactions et du temps qui passe ; luminescent sur l’avant-bras, il devient terne quand le « temps à vivre » atteint zéro, ce qui, on l’aura compris, est synonyme de mort. De plus, telle une mesure de « paix sociale », la métropole du futur dans laquelle se déroule Time Out est divisée en différents quartiers, des territoires définis par le niveau de vie de ses habitants ; des péages sanctionnent le passage d’une zone à une autre. Le coût de ces péages se comptant, bien évidemment, en temps : en jours, en semaines… même en mois !
Certains films de science-fiction ou d’anticipation indiquent une date dans le futur au cours de laquelle se déroule l’intrigue. Le film Time Out, lui, ne donne que très peu de moyens pour évaluer cette distance dans l’avenir. En effet, les différences technologiques ou sociales avec notre présent sont ténues. Les lieux, les objets que nous croisons tout au long du film sont ceux que nous pouvons côtoyer au quotidien. La principale de ces différences repose sur la généralisation d’un contrôle génétique qui s’applique à l’ensemble de la population d’un même État.
Dans le réel, on reste loin et même très loin d’un avenir où l’humanité serait capable — un — d’éradiquer génétiquement la mort et — deux — de transférer à l’ensemble de la population humaine d’un pays une telle mutation génétique. Reste que les deux postulats sociaux — disparition de la monnaie fiduciaire et cloisonnement de la ville —, eux, ne sont peut être pas si éloignés que cela de nous…
Un réel qui fait de l’œil la fiction
Commençons par nous interroger : « Nos villes sont-elles ou non sous la menace de ne plus être des espaces urbains d’échanges et de libre circulation ? ». Après un « non » immédiat et évident, à bien y réfléchir, on pourrait néanmoins évoquer certaines populations qui s’interdisent à se rendre dans certains lieux — théâtres classiques, opéras, lieux de conférence —, ce qui peut arranger une autre tranche de la population. Ailleurs, ce sont certains quartiers où la représentation publique n’est plus souhaitée — pompiers, ambulances, plombiers et électriciens, sans même parler des forces de l’ordre…
À entendre ce qui précède, on pourrait être en droit de dire que l’auteur se permet des conclusions alarmistes et hâtives, tirant, avec une forme de légèreté, sur des ficelles qui servent son propos. Peut-être… Cependant, la liste des exemples d’autres formes de ville peut continuer à s’allonger en y ajoutant les gated communities, ces communautés élitistes dont le nombre, à l’échelle de la planète, ne cesse de croître. On peut commencer par citer les villes d’Orania et de Kleinfontein, en Afrique du Sud. Au prétexte de préserver la culture Afrikaners, ces deux communautés fleurent bon l’Apartheid — ad nauseam — puisqu’on y vit, de manière revendiquée et assumée, qu’entre blancs. Moins sulfureuse mais tout aussi dystopique sous des atours alléchants, il faut ensuite citer The Line-Neom, le projet urbain le plus dantesque qui soit : un seul et unique bâtiment long de 170 km, haut de cinq cents mètres et large de deux cents. Prévu pour être bâti au milieu du désert saoudien, ce projet est promu par Mohammed Ben Salmane, l’actuel homme fort d’Arabie Saoudite. Si son développement arrive à son terme, Neom sera un espace unique, clos, climatisé et contrôlé. Il faudra bien évidemment montrer patte blanche et compte bancaire bien nanti pour compter parmi les « élus » de The Line. On le voit, hors de nos frontières — en est-on si sûr ? — tous ces éléments pourraient s’avérer être les graines de l’avenir tel qu’il est décrit dans Time Out.
La tentation de la convergence des données
Concernant la disparition de la monnaie fiduciaire, déjà, un constat : malgré la montée en puissance des paiements dématérialisés, nous utilisons toujours billets et pièces de monnaie sonnantes et trébuchantes. Cependant, d’autres dispositifs dématérialisés sont en voie de déploiement. Ils pourraient être les prémices de l’obligation de n’utiliser que les paiements électroniques. Ce jour arrivé, plus aucune transaction — même de quelques euros ou au sein d’une même famille — ne se fera sans l’intervention d’un tiers certificateur — banque ou état.
Si la disparition de la monnaie fiduciaire ne semble pas encore à l’ordre du jour, les dématérialisations de certains aspects de notre quotidien vont bon train. Regardez : quand nous remplissons notre déclaration d’impôts, voilà quelques années que celle-ci se trouve préremplie de nos revenus de l’année concernée grâce aux informations liées à nos activités salariées ou chômées, liées aux allocations qu’on peut percevoir. Elles sont collectées par l’administration fiscale auprès des organismes sociaux, par exemple l’Urssaf ou la CAF. Un pont informatique a donc bien été bâti entre ces différentes administrations. D’autres étapes de dématérialisation sont annoncées : généralisation de l’usage de l’IA sur les caméras de vidéosurveillances urbaines, déploiement du dossier médical numérique et, à une échéance plus lointaine, on pourrait évoquer le vote électronique.
Des outils à double tranchant
Pour chacun de ces exemples, il existe des avantages objectifs… et des inconvénients latents. Concernant l’usage de l’IA appliquée à la vidéosurveillance, il a été testé en France lors des J.O. de Paris 2024. Il a permis le repérage des comportements suspects dans la foule. Les autorités garantissent qu’il n’y a pas eu d’identification systématique de l’ensemble des personnes présentes à l’image… bien que la machine serait tout à fait capable de le faire. Dans le cas du dossier médical, bien des malades verront leur quotidien simplifié une fois que les médecins qu’ils consultent pourront avoir accès à l’ensemble de leur dossier médical sans risque de pertes de pièces, d’analyses, de comptes rendus de scanner, de radio… Il faut juste éviter qu’un petit malin ne trouve le moyen de collecter ce genre de données pour les revendre au plus offrant… Il en va de même pour le vote électronique qui, malgré les sécurités garanties et les discours rassurants, trace une voie vers le risque d’une manipulation de nos institutions démocratiques.
L’informatique n’étant pas une science exacte, à chaque fois que l’on évoque la dématérialisation d’un aspect du réel tangible, il faut envisager le risque d’une manipulation : dans chaque ligne de code peut se cacher une trappe qui, si elle n’est pas systématiquement utilisable par la malveillance de pirates informatiques, elle peut néanmoins miner le rapport de confiance qui doit exister entre l’individu-citoyen et l’opérateur public ou privé de ces services dématérialisés. Cette manipulation pouvant se faire à l’encontre de l’individu « émetteur » de ces données. Prenez le cas des montres connectées qui savent tout de nos activités physiques et donc de l’évolution de notre santé ; elles enregistrent nos faits et gestes, les rythmes de notre cœur, la qualité de notre sommeil. Autant de données qui seraient très utiles à un assureur pour évaluer les risques liés à tel ou tel mode de vie. Heureusement, pour le moment, la France et l’Europe semblent avoir fermé la porte à la création d’un pont informatique entre l’opérateur de ces données et un assureur. La Belgique a même modifié sa loi relative aux assurances pour interdire, entre autres, à une assurance de refuser un contrat ou d’augmenter le coût d’un produit si le client assuré refusait d’acquérir ou d’utiliser un objet connecté.
La citoyenneté au risque de la dématérialisation
Pourtant, à l’autre bout de la planète, un État, la Chine, s’est résolument engagée vers un contrôle informatique d’État quasi total des individus au moyen d’un système de crédit social. Certains chinois y voient un jeu grandeur nature. À l’inverse, les citoyens les moins bien notés voient leurs accès aux administrations ou certains services restreints, ne serait-ce que l’achat d’un billet de train… En Chine, la convergence des données concernant chaque individu permet de payer un service ou un bien avec son seul visage, sans avoir, auparavant, donné son accord pour un tel usage.
Terreur pour certains, confort pour d’autres. Et, finalement, on s’aperçoit surtout qu’on n’est pas si loin que cela du monde de Time Out ! Pour en arriver à l’avenir tel qu’il est décrit dans le film, hormis l’aspect génétique, il aura fallu que la dématérialisation de notre quotidien ne cesse d’augmenter. Il aura fallu que les données collectées ne cessent de converger. Il aura fallu qu’au nom du confort et de la tranquillité des esprits et des corps, le citoyen ait abdiqué à bien des libertés.
Au cours de cette analyse, il a été fait plusieurs fois mention de démocratie, de citoyenneté, de libertés. On pourrait ajouter à cette liste le respect de la vie privée, le droit à l’oubli numérique, le droit au tangible ! Qu’on le veuille ou non, les outils numériques sont dans notre quotidien et ils y resteront. Par contre, parce que nous sommes en démocratie, nous avons le droit et le devoir de faire savoir ce que nous voulons comme usages pour ces outils.
la newsletter
la newsletter
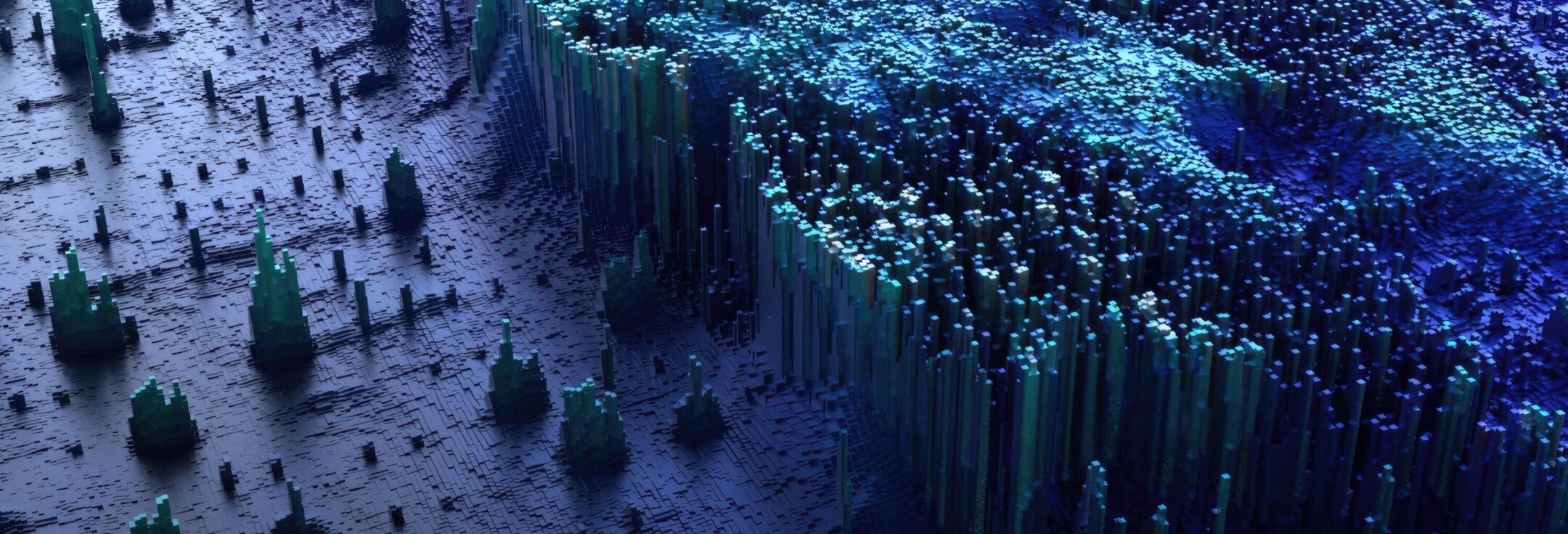
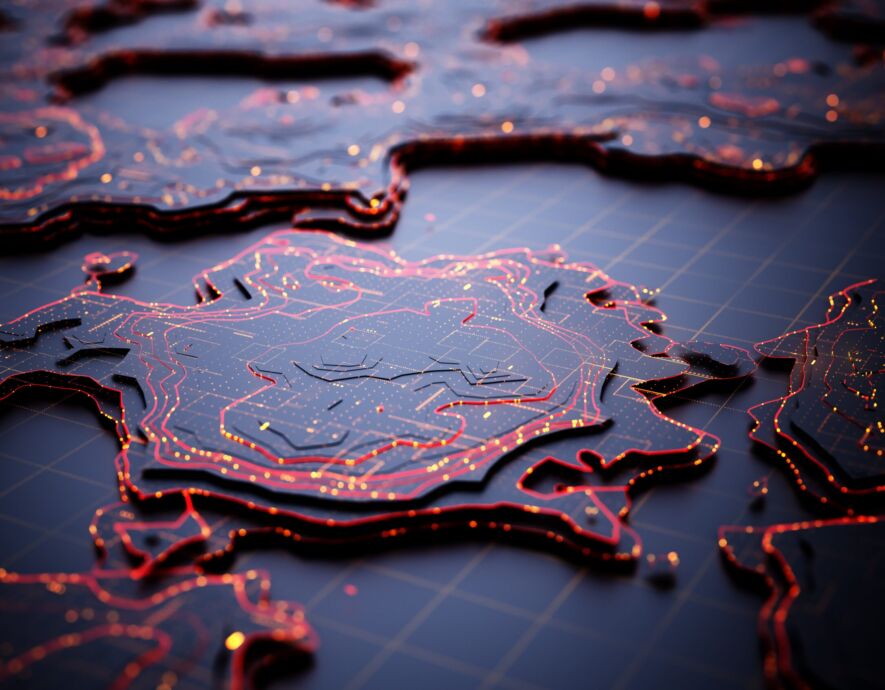
![Image [INTERVIEW] Daniel Blanc, nouveau directeur général du Forum INCYBER Canada](https://incyber.org//wp-content/uploads/2024/09/incyber-news-cybersecurite-cybersecurity-data-donnees-4-2024-885x690.jpg)