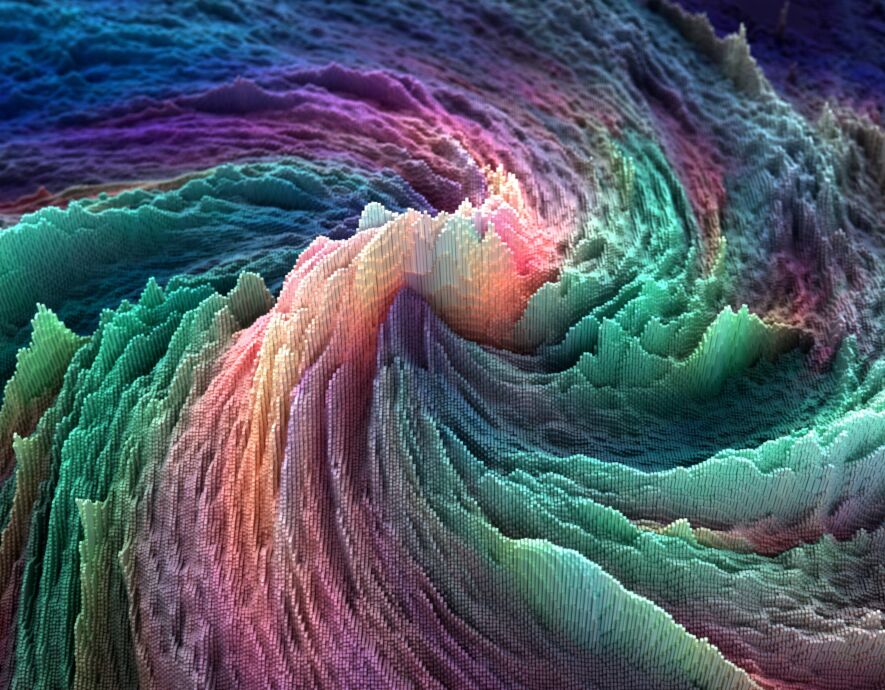La série commence sur un constat commun avec notre réalité : la masse des citoyens, en pleine défiance à l’égard des institutions, se détourne des canaux d’informations habituels au risque de se laisser aller aux excès complotistes. Dans une scène du premier épisode de la série, il faudra tout le talent oratoire de Georges Mullen, l’ancien président chargé de l’enquête joué par Robert De Niro, pour ramener miraculeusement une foule à la raison. Cette raison durera-t-elle ? C’est un des enjeux de la série. Alors, à l’issue du visionnage de la série (en binge watching, je l’avoue…), on peut s’autoriser au moins trois réflexions. La première pourrait être résumée en « De la revanche des boomers », la seconde « Du mariage opportuniste entre la tech et la politique » et en définitive « De la fragilité de nos sociétés technologiques ».
Les Boomers reprennent-ils vraiment du service ?
La réflexion intitulée « De la revanche des boomers » s’incarne en Robert De Niro, octogénaire vaillant dans son rôle d’ancien président américain apprécié de ses concitoyens comme de l’administration. Cet intitulé est à lier avec l’expression « Ok, Boomer ! ». Cette expression, née au début des années 2000, renvoie les générations nées de la Seconde Guerre mondiale à leurs responsabilités dans l’état du monde que reçoivent les plus jeunes générations. Celles-ci étant tout à la fois envieuses et aigries des Trente glorieuses, période fantasmée qui été la toile de fond de la jeunesse de ces aînés jugés coupables sans procès. Cette jeunesse est aussi en colère du constat d’impuissance ou de résistance aux nécessaires évolutions de la société planétaire contemporaine face aux changements climatiques avérés et à leurs manifestations de plus en plus violentes. Aux yeux des jeunes générations, le monde semble incapable de changer de « logiciel », en termes de consommation, de production, de géopolitique… de comportements individuels et collectifs.
Comment, alors, un vieux président qui semble se débattre contre les démons de la sénescence pourrait résoudre une enquête qui se déroule dans un monde dont il pourrait ne plus posséder les clés de compréhension ? La série est-elle honnête quand elle semble faire l’impasse sur les questions d’environnement ? Est-elle honnête quand elle met au centre de l’intrigue un vieux mâle blanc et hétérosexuel ? Fait-elle, avant l’heure, le jeu de la politique de l’actuel locataire de la Maison Blanche ? Il est important, ici, de rappeler que la série a été conçue en 2022, bien avant la nouvelle accession au pouvoir de Donald Trump.
Quand la politique se met à « fricoter » avec la Tech
En contrepoint de ces légitimes interrogations, on peut aborder notre second thème de réflexion « Du mariage opportuniste entre la tech et la politique ». Sans trop divulgâcher l’intrigue de la série, on découvre à un moment que politique et high-tech se rapprochent jusqu’à entretenir des relations « contre nature », sûrement jusqu’au conflit d’intérêt. En pointant la mise en évidence de ce travers fictionnel, on pourrait être tenté de faire un parallèle avec le réel, aux USA. Il faut une nouvelle fois replacer la chronologie de la production de la série dans l’histoire américaine récente. Ainsi, en 2022, au moment du lancement de la production de la série, rien ne laissait présager le rapprochement entre Elon Musk et Donald Trump, jusqu’à la nomination du tonitruant multiple entrepreneur à la tête du DOGE, cette étrange organisation aux puissants pouvoirs sans pour autant avoir le statut de département fédéral, de ministère, dans le vocable français. On peut juste noter que, fin 2022, Musk rachetait Twitter, ceci marquant peut-être son passage d’entrepreneur atypique de génie à acteur de la vie publique américaine. Le concernant, on ne parlait pas encore de politique, même si déjà à cette époque, l’attachement de Musk à une liberté d’expression absolue – libertarienne (?), en tout cas, au détriment de toute modération – était déjà au cœur des débats.
Ces précisions historiques prises, ce mariage entre le monde politique et celui des entrepreneurs de la tech, qualifié ici d’opportuniste, prend, dans la série Zero Day, toute sa dimension. Là, il n’y a plus vraiment de parallèle à faire entre la série et le binôme Trump/Musk. Dans la série, le politicien qui se compromet dans l’attaque informatique est juste un Républicain habitué de la scène politique américaine, particulièrement conservateur et surtout très paternaliste. Il pense que le peuple a besoin d’une « bonne leçon » de démocratie. Les moyens que lui et ses acolytes vont mettre en œuvre sont des plus dérangeants. Si parallèle il y a à faire entre la réalité et la fiction, c’est peut-être entre Musk et la patronne d’un réseau social qui intervient dans l’intrigue de la série : mêmes personnalités imbues d’elles-mêmes, sûres de leurs faits et de la pertinence de leurs actions… tout cela au nom d’un idéal qui frise la seule opportunité commerciale, stratégique – de démiurge ? – afin d’effacer toute concurrence. En définitive, la politique et la tech se fourvoient réciproquement dans cette alliance qui s’avère, entre eux, un jeu à somme nulle… sans parler des nombreuses pertes, si on se place d’un point de vue global de la société où ils agissent.
L’informatique porterait-elle en elle la semence d’un cygne noir ?
Reste à traiter notre troisième réflexion : « De la fragilité de nos sociétés technologiques ». Je n’aborderai pas la dimension de faisabilité de l’attaque informatique telle qu’elle est décrite dans la série. Seule information fournie par la série : une ferme clandestine de serveurs informatiques est évoquée. Est-elle suffisante pour lancer une attaque qui tirerait profit de failles informatiques présentes dans tous les systèmes d’un pays de la taille des USA, sans jamais avoir été référencées et renseignées ou même juste identifiées ? C’est peut-être là la plus grosse licence creative que se sont autorisés les auteurs et, pour les spectateurs, le plus gros effort de « suspension volontaire de son incrédulité » à réaliser !
Mais, que cette attaque soit réalisable ou non, il y a d’autres conditions qui pourraient aboutir au même résultat : le blocage plus ou moins instantané d’un pays, voire même de tout ou partie de la planète. En prospective c’est ce qu’on appelle un cygne noir, c’est à dire un événement avec un très faible taux de réalisation – tellement faible que l’événement passe sous les radars ou, pire, qu’il demeure de l’ordre du non pensé, sous les coups d’une omerta intellectuelle et collective plus ou moins volontaire – mais qui néanmoins advient ou, à l’inverse, un événement avec un énorme taux de réalisation mais qui n’advient pas. Nous avons tous récemment vécu le premier cas. Ce cygne noir s’est appelé la COVID-19.
Indépendamment du côté piratage massif, le cygne noir que je veux évoquer ici est le risque que, un jour, la Terre se trouve prise dans les « vents » de particules à hautes énergies qui auraient été émis par une puissante tempête solaire. Sans rentrer dans les détails – on peut aller voir la chronique Red Planet sur Space’ibles (https://cnes.fr/projets/spaceibles/inspirations) –, si un jour la Terre était frappée par un de ces événements solaires à très haute énergie, tous les systèmes électroniques situés du côté éclairé par le Soleil, jusqu’à la zone de pénombre, seraient instantanément désactivés, voire partiellement détruits. Tous les systèmes informatiques de tous les appareils pris dans cette tempête s’arrêteraient. On parle de satellites (communication, GPS et autres…), d’avions, de trains, des systèmes d’alimentation et de régulation électrique, de nos ordinateurs (dans les hôpitaux, les banques…), de nos chers téléphones… J’en passe et des meilleurs !
Dans la série Zero Day, Robert De Niro est chargé de retrouver les « méchants ». Dans le cas d’une tempête solaire, il n’y aurait personne à condamner. Il y aurait juste un événement avec un très faible taux de réalisation qui advient ! C’est ce que nous raconte cette série avec tout le talent dramatique américain. Ce qu’elle pointe du doigt c’est la fragilité de nos sociétés modernes, ce qu’elle pointe c’est la dépendance à l’informatique sous laquelle nous sommes tous tombés.
Du bon usage de la résilience
Alors, au visionnage de cette série, la question que l’on est en droit de se poser, dès aujourd’hui, est de savoir quelles capacités de résilience nos sociétés sont dotées pour faire face à un tel événement, qu’il soit volontaire ou accidentel. Quelles compétences devrions-nous acquérir ou conserver, (ré)apprendre ou imaginer ? Un exemple : en France, on est en train de démonter les lignes téléphoniques dites RTC. Il s’agit du fil de cuivre qui pendant plus d’un siècle a porté nos communications téléphoniques, puis récemment notre cher ADSL. Aujourd’hui, il est remplacé par de la fibre optique et les relais cellulaires. Il est évident que, quand tout va bien, la fibre est bien plus efficace pour transmettre un signal informatique. Mais en cas de catastrophe informatique, une bonne ligne de cuivre, ça peut permettre de communiquer d’un point à un autre d’un territoire avec un simple signal électrique ; ça peut permettre de coordonner des actions de secours.
De même, on voit les émissions radios analogiques, FM ou AM, être petit à petit désactivées, au profit de la RNT, la Radio numérique terrestre. Et nous, auditeurs, sommes invités à acheter des postes de radio numériques. Encore une fois, en cas de catastrophe, ce foutu cygne noir qu’on ne veut pas voir et qui pourtant fini par pointer le bout de son nez. Être en capacité d’envoyer un signal radio analogique, non dépendant de l’informatique, et de le recevoir collectivement relève, une nouvelle fois, d’une résilience technologique au service de la société. Tout cela étant dit sans tenir compte des systèmes de protection qui pourraient être adaptés aux systèmes essentiels, qui ne sont pas que militaires…
En analysant de la sorte Zero Day, je ne fais pas un Coming Out technophobe. Bien au contraire. Aimant mes outils informatiques, je m’interroge sur ce que nos sociétés modernes et technologiques devraient entreprendre pour devenir plus fortes, plus résistantes aux chocs de l’avenir, que ces chocs soient de l’ordre de l’éthique et des rapport entre générations, qu’ils soient politiques jusqu’à fragiliser nos démocraties ou bien encore de l’ordre des changements de paradigmes, en un instant comme sur le long terme. Il faut alors s’interroger : comment nos sociétés modernes devenues géants aux pieds d’argile vont-elles se protéger de ces chocs qui pourraient bien les précipiter à terre si rien n’est entrepris pour leur donner de la souplesse, pour les doter de systèmes résilients ? Il est intéressant de noter que le terme résilient est utilisé ici dans son entendement premier – capacité d’un matériau à absorber l’énergie d’un choc en se déformant – et non dans ses dimensions psychologique et sociale, mention utilisée jusqu’à l’usure.
la newsletter
la newsletter
![[ZERO DAY] ou « l’informatique, ver dans le fruit de nos sociétés modernes ? »](https://incyber.org//wp-content/uploads/2024/09/incyber-news-cybersecurite-cybersecurity-data-traitement-donnees-3-2024-1920x735.jpg)
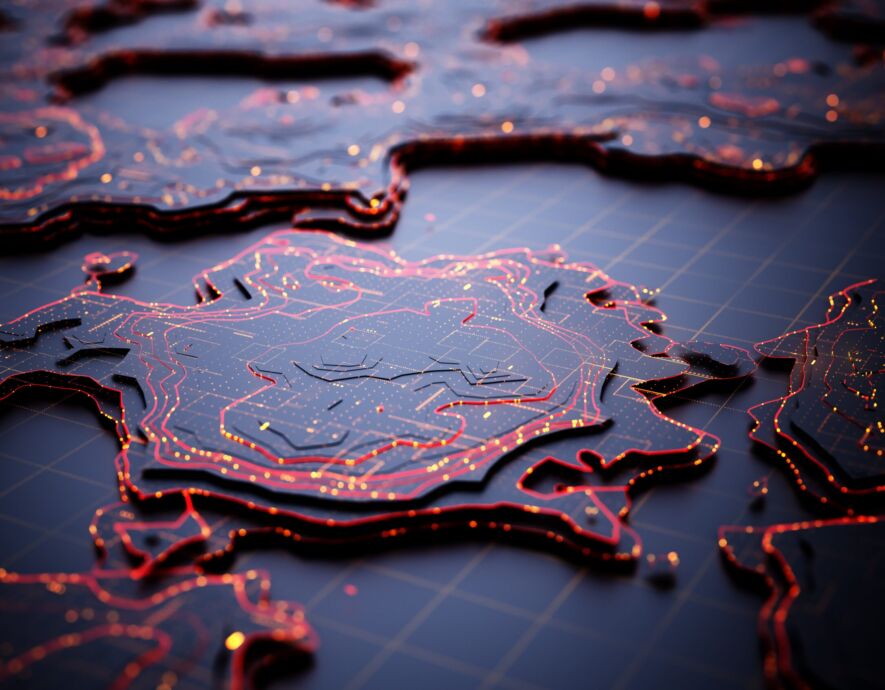
![Image [INTERVIEW] Daniel Blanc, nouveau directeur général du Forum INCYBER Canada](https://incyber.org//wp-content/uploads/2024/09/incyber-news-cybersecurite-cybersecurity-data-donnees-4-2024-885x690.jpg)