
- Accueil
- Cyber stabilité
- Data centers orbitaux : bientôt une réalité ?
Data centers orbitaux : bientôt une réalité ?


Verra-t-on un jour des structures dédiées au traitement des données numériques autour de la Terre ? Aussi futuriste que cela paraisse, cette possibilité est aujourd’hui envisagée. La société Thales Alenia Space (TAS) planche sur le sujet dans le cadre de l’initiative ASCEND mise en place par la Commission Européenne avec un objectif : contribuer à réduire l’empreinte écologique.
Pour limiter l’impact du changement climatique sur Terre, Jeff Bezos, le patron du groupe Amazon, suggérait il y a quelques années de transférer la totalité des industries lourdes dans l’espace. Cette idée n’est pas nouvelle puisque dès la fin des années 1960, la NASA étudiait déjà la possibilité de bâtir d’immenses structures dans l’espace comme les centrales à énergie solaire. Ce concept est présenté dès 1968 par l’ingénieur américain Peter Glaser. En ces temps de changement climatique, l’installation de grandes plateformes orbitales, dont ces fameuses centrales solaires, pourraient donc être une option.
Mais d’ici la prochaine décennie, ce sont également les data centers qui pourraient être concernés. A la fin 2022, on en dénombrait 264 sur le territoire national. Il faut dire que leur consommation énergétique s’avère particulièrement importante car leur refroidissement exige beaucoup d’énergie. Selon un rapport de la Commission Européenne de 2020, l’alimentation en électricité des data centers européens est passée de 53,9 à 76,8 TWh/an entre 2010 et 2018. On lit dans ce même rapport que cette consommation pourrait encore augmenter de 21 % d’ici 2025, pour passer à environ 92,6 TWh/an.
Et d’ici à dix ans, les data centers terrestres pourraient encore ponctionner 15 à 20% d’énergie. La partie la plus gourmande n’est pas le stockage des données mais le « processing » des microprocesseurs. Alors pour limiter leur empreinte environnementale, pourquoi ne pas les installer, eux aussi, directement dans l’espace ? Fin 2022, la Commission Européenne a donc mandaté l’entreprise franco-italienne Thales Alenia Space (TAS), joint-venture entre Thales et Leonardo, pour étudier cette question.
Comparable à l’ISS
Dès janvier 2023, TAS a débuté les premiers travaux sur cette étude dénommée ASCEND (Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty ou Cloud spatial avancé pour la zéro émission nette en Europe et la souveraineté des données) de la Commission Européenne. Autour de TAS sont également réunies plusieurs entreprises avec une expertise complémentaire dans les domaines environnementaux (Carbone 4, Vito) du Cloud (Orange, Cloudferro, Hewlett Packard Entreprise Belgium) des lanceurs (ArianeGroup) et des systèmes orbitaux (Airbus DS et l’agence aérospatiale allemande DLR).
Ce projet pourrait contribuer à l’objectif Green Deal européen qui vise à la neutralité carbone d’ici 2050. Il a deux objectifs : démontrer que le déploiement de futurs data centers en orbite héliosynchrone (SSO) à 1 400 km (comme suggéré par TAS), émet moins d’émissions de CO2 que ceux installés au sol. Selon les premières informations communiquées par la société franco-italienne, une installation sur orbite SSO est requise notamment pour les contraintes de latence dans la transmission des données et pour optimiser le rendement en énergie solaire.
Le second objectif : définir la solution de lancement la plus adéquate, et la plus verte, pour leur mise en place autour de la Terre. Nous n’en sommes encore pour le moment qu’au stade préliminaire de l’étude mais, sur le papier, « il n’y a rien qui empêche la réalisation », déclare Yves Durand, directeur des technologies chez TAS et en charge du projet ASCEND. Techniquement, on parle de structures qui pourraient avoir la taille de l’actuelle Station spatiale internationale (ISS) soit l’équivalent du Stade de France en orbite. Un élément de base d’un data center, pour avoir une fonctionnalité qui réponde à un besoin terrestre, représente l’équivalent d’un gros container de camion, soit environ trente tonnes.
« Pour l’alimenter en énergie électrique, il faut compter sur des panneaux solaires faisant à peu près la taille d’un terrain de foot », ajoute Yves Durand. Il envisage qu’ils puissent également être alimentés par de futures stations à énergie solaire sur lesquelles l’Agence spatiale européenne (ESA) se penche également. C’est le projet SOLARIS, dont la faisabilité est également étudiée par la société TAS. Il est en effet prévu d’utiliser sur place l’énergie produite en dehors de l’atmosphère terrestre et de n’échanger avec le sol que le haut débit Internet grâce aux communications optiques.
Nécessité d’un super lanceur
Afin que la chose reste financièrement accessible, le dispositif envisagé reste fondé sur l’utilisation de l’intelligence artificielle et de futurs remorqueurs (tugs) orbitaux automatiques dont l’utilisation pourrait se banaliser d’ici la prochaine décennie. Dans l’immédiat, aucune intervention humaine n’est envisagée à courte comme à moyenne échéance. Mais l’idée est aussi de pouvoir disposer d’une structure facilement modulable dans l’espace.
Ainsi, les éléments qui nécessiteront un remplacement doivent pouvoir être redescendus par un véhicule robotisé. Ces techniques doivent notamment faire l’objet d’un test en orbite avec le futur véhicule EROSS IOD à partir de 2026. Si l’expérience s’avère concluante, un projet de plus grande échelle pourrait voir le jour à l’horizon 2035. Mais, quel que soit la forme que prendra le premier data center orbital, s’il se concrétise, il nécessitera obligatoirement l’utilisation de nouveaux moyens de lancement. C’est là le second point. Et ce sera très probablement l’un ou l’autre successeur d’Ariane 6, dont le premier vol est maintenant planifié courant 2024 au moment de l’écriture de ces lignes.
L’installation de structures orbitales lourdes requiert, en effet, des lanceurs de grande capacité. A l’heure actuelle, les moyens d’accès à l’espace les plus performants sont le Space Launch System (SLS) de la NASA, pour le programme lunaire Artemis, qui a une capacité de 95 tonnes sur orbite terrestre basse (LEO), ou encore le Falcon Heavy de Space X (63,8 tonnes en version non récupérable). Le vecteur de lancement envisagé par l’ESA, qui n’en est encore qu’au stade de la planche à dessin, s’appelle PROTEIN (euroPean Reusable and cOsT hEavy lift transport InvestigatioN, ou Investigation pour un lanceur européen super-lourd et réutilisable).
L’Agence spatiale européenne a ainsi signé deux contrats avec ArianeGroup et l’Allemand Rocket Factory Augsburg (RFA), à hauteur de 500 000 euros chacun, pour plancher sur la question. Selon les informations disponibles, il devrait être récupérable et doit pouvoir délivrer jusqu’à 100 t en orbite basse afin de répondre à des cadences permettant de satelliser jusqu’à 10 000 t par an ! Ce projet rentre dans le cadre du programme préparatoire des futurs lanceurs (FLPP) de l’ESA, confié à parts égales au CNES, à l’agence spatiale italienne (ASI) et son homologue allemand, le DLR.
Il y a d’ailleurs un précédent. Dans les années 1990, le CNES avait demandé à EADS/Astrium de plancher sur un concept de lanceur de capacité comparable à la Saturn V des années Apollo. Il s’agissait d’une « super » Ariane 5 destinée à lancer un véhicule habité sur une trajectoire lunaire. La masse de la charge utile aurait été d’environ 90 tonnes sur orbite basse. Dans le cas de PROTEIN, le transport humain n’est pas prévu, bien que l’option reste possible techniquement.
Anticiper les intrusions
Se pose également la question de la sécurité des futurs data centers orbitaux. Un système orbital reste par définition isolé et une tentative d’abordage n’est pas à exclure mais elle reste malgré tout difficilement envisageable. « Une intrusion humaine à 1 500 km d’altitude n’est quand même pas forcément très évidente même si des pays peuvent venir nous chercher des noises », souligne Yves Durand. Ce dernier indique aussi que le piratage par radiofréquence reste une possibilité.
Il est en effet techniquement possible de prendre le contrôle à distance d’un satellite, comme cela a été démontré par Thales lors de la troisième édition du Cysat les 26 et 27 avril 2023 et pour laquelle l’ESA avait mis à disposition son petit démonstrateur technologique, le nanosatellite de 7 kg (3U) OP-SAT. L’équipe de cybersécurité offensive de Thales a donc relevé le défi en identifiant des vulnérabilités permettant de perturber le fonctionnement du satellite. Pour en prendre le contrôle, l’équipe composée de quatre personnes est parvenue à s’introduire dans le satellite en exploitant plusieurs faiblesses.
Elle a compromis les données retransmises vers la Terre en modifiant notamment les images captées par le satellite. Durant cette expérience, l’ESA avait toutefois toujours accès au satellite. Les futurs data centers installés autour de la Terre devront donc offrir une sécurité optimale, entre autres pour la maintenance, mais aussi pour les futurs clients qui restent encore à déterminer. Si ce grand projet se concrétise, (toutes ?) nos données pourraient donc un jour trouver refuge entre la Terre et la Lune.
la newsletter
la newsletter
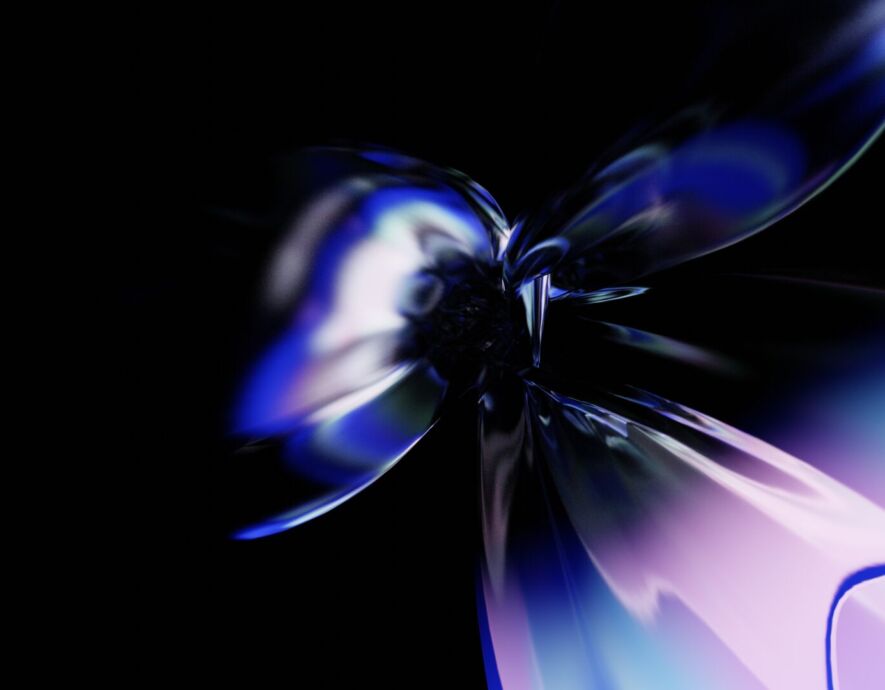
![Image Un site du [gouvernement français] visé par des nationalistes turcs](https://incyber.org//wp-content/uploads/2024/04/incyber-news-cybersecurite-cybersecurity-pays-countries-attack-2024-885x690.jpg)
![Image Le groupe pro-russe APT29 cible des [élus allemands du CDU]](https://incyber.org//wp-content/uploads/2024/04/incyber-news-cybersecurite-cybersecurity-group-people-2024-885x690.jpg)